AGROPASTORALISME
Page
11 AURE
On
connaît mieux, surtout depuis la réintroduction des ours dans les Pyrénées
Centrales, l’agropastoralisme dont on ne voit que la transhumance.
Pourtant
quel monde se cache derrière toutes ces traditions ! C’est vrai, je vous
l’accorde : de voir passer ces troupeaux magnifiques de vaches et de moutons
décorés, c’est magique. L’émotion est au rendez-vous.
Si
vous saviez comme ces superbes animaux ont envie de gagner les pâturages d’altitude,
là où il fait bon l’été, où il y a bien moins de mouches qui agacent et font
mal et où surtout, il y a la liberté ! c’est pour cela qu’ils courent sur
l’asphalte qui pourtant leur agace les pieds.
Les
bergers et vachers sont obligés de ralentir leur course. Oui, la transhumance,
c’est magique. Mais derrière ce mot, qu’elle organisation !
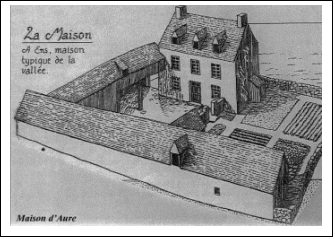 Alors, la société agropastorale ?
Alors, la société agropastorale ?
Nous
parlerons de celle d’Aure à partir d’ un mémoire du Brevet d’État
d’Accompagnateur de montagne en 1997, présenté et obtenu par Olivier de Sulauze
pour fêter, quelque part, la transhumance. Bien sûr, chaque vallée avait ses
traditions mais dans l’ensemble, le labeur et le mode de vie se ressemblaient.
Les paysans travaillaient dans la même direction, avec les mêmes buts, mais
adaptaient leur habitat, leur outils, leur méthodes de travail en fonction du
relief de la vallée ou de la plaine. Les
troupeaux partaient et partent toujours vers les estives l’été. L’herbe
d’en bas était alors coupée, séchée et engrangée.
Cette
fonction élémentaire et déterminante de l’économie et de la survie des
populations, dépendait de toute une
organisation sociale qui part de la maison, puis de la communauté villageoise
et valléenne. En haut de la pyramide, il y avait l’administration inter-vallées
avec une organisation hiérarchisée de la société.
Le point d’ancrage : la famille.
« La
maison est l’élément fondamental de la communauté agropastorale ; c’est le
point de fixation au sol autour duquel la famille se groupe, se perpétue et d’élargit.
La maison est héréditaire et immuable ; c’est elle qui porte le nom de la
famille et qui a la personnalité morale et juridique dans le cadre du village
et de la vallée.
Cette
« famille souche » est fortement hiérarchisée, le père ou la mère, le
fils ou la fille aînés représentent la continuité de la lignée ; ils possèdent
le patrimoine, administrent les biens, dirigent les travaux. Les autres
enfants, les cadets et les cadettes, voués à un quasi-servage, sont astreints
aux besognes inférieures, ou bien à celles qui les éloignent de la maison sans
pour autant les affranchir des devoirs familiaux.
Les
aînés sont voués par la coutume au maintien de l’ordre, à la stabilité. Dès
l’enfance, ils jouent le rôle de futurs père et mère. Les autres, les puînés,
sont voués au nomadisme : à la garde des troupeaux, au départ vers les villes,
à l’usine, à l’étranger… ou à la vocation religieuse ! Aussi dans la famille
souche ne peuvent être réunis que deux couples sous le même toit : celui du
maître de maison et celui de son héritier. »
Il
faut remarquer toutefois que les cadets pouvaient rester sur l’exploitation
s’ils le désiraient, ils jouaient alors le rôle de domestique et ne se
mariaient pas. Ils pouvaient être également placés dans un autre
« maison » sans gagner aucun droit qui les sortiraient de leur
condition d‘infériorité. Ils pouvaient épouser un ou une aîné(e) et quittaient
la maison pour fonder une autre famille souche plus loin, soit dans le village,
soit dans la vallée soit encore dans une vallée voisine. Cela ne voulait pas
dire qu’ils allaient avoir une vie agréable de chef de famille, ils devenaient
en général les domestiques de leurs conjoints. Les parents arrangeaient les
mariages en se rencontrant de préférence sur les marchés perpétuant sans le
moindre remords une société basée sur les inégalités instaurées pour des
raisons de conservation du patrimoine et pour la cohésion de la communauté.
Mais au fil des temps, elles dévièrent. Quelques survivances de ces traditions
subsistent dans l’inconscient collectif.
En
quittant la famille, le fils ou la fille cadet(te) abandonnait tout ce qui
avait fait sa vie pour se fondre dans sa nouvelle famille mais apportait
toujours une « dot » : une paire de vaches, quelques moutons… Le
surnom faisait office de nom et les domestiques étaient désignés de la même
manière.
Une organisation autour de la maison.
Olivier
de Sulauze présente dans son ouvrage plusieurs modèles de maison auroise. Il
écrit : « Dans la communauté agropastorale, La Maison fait la
famille et non l’inverse. La bâtiment a non seulement un rôle pratique -abriter
la famille et ses activités - mais aussi un rôle social très important : il est
représentatif de la famille devant la communauté ; sans maison, la famille n’a
pas droit de cité. Murs épais montés en pierres solides et protégés d’un
enduit, charpente résistante couverte de schistes ou d’ardoises, la maison
d’Aure est bâtie pour durer longtemps. Elle s’organise et s’ordonne autour de
la cour, espace partiellement clos qui symbolise bien l’univers familial :
abri, protection, intimité. Partie intégrante de la Maison, la cour en
constitue une sorte de pièce extérieure. la cour est lieu de rencontre et l’axe
des différentes fonctions de la Maison ; elle est le cœur de la vie familiale.
La cour a une telle importance que le portail qui en constitue le seuil est
bien plus mis à l’honneur que la porte même de l’habitation. D’une certaine
monumentalité, c’est un édifice en soi, qui marque avec ostentation le passage
du domaine communautaire au domaine de la maison ».
Il
est très intéressant de s’attarder sur les anciennes demeures dans chaque
vallée. Si dans les villages, elles ont des points communs, elles changent de
vallée à vallée. Celles d’Aure sont imposantes et particulièrement décorées.
A suivre
Damien Sallente
Cet
ouvrage est disponible dans les librairies de la vallée d’Aure sous le titre :
La vallée d’Aure aux temps de
l’agro-pastoralisme.
Gazette - Sommaire
- Partenaires Arborescence